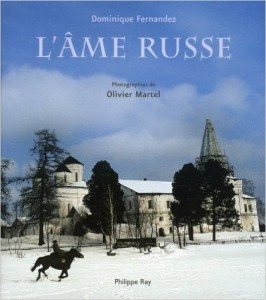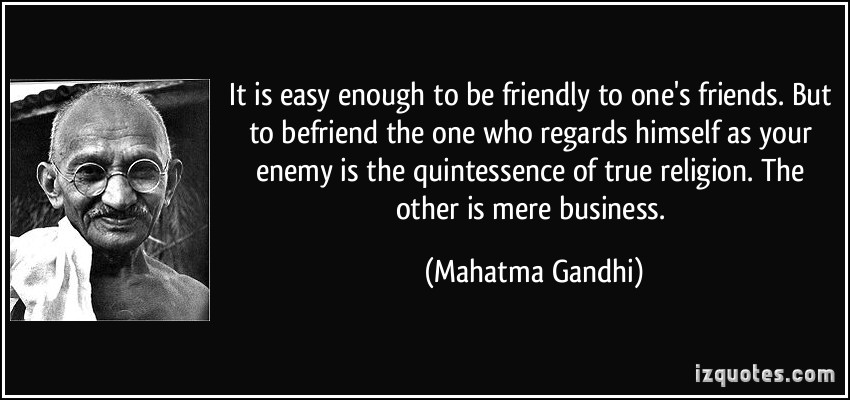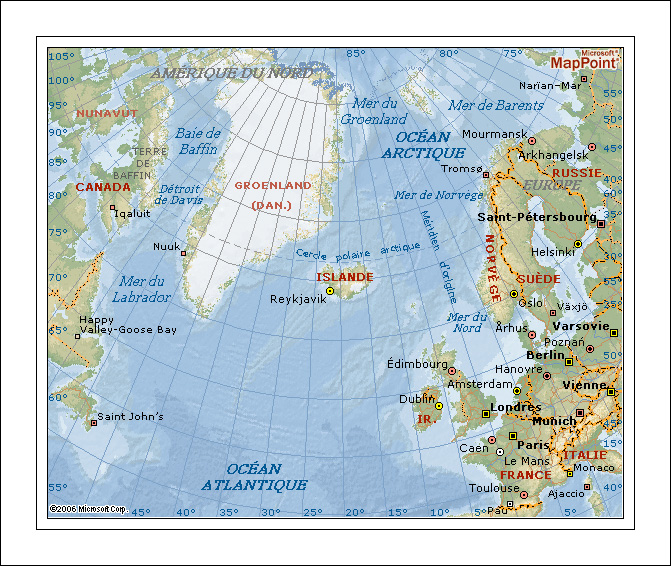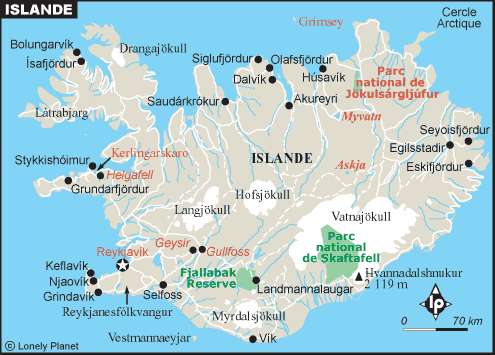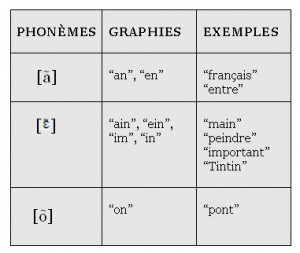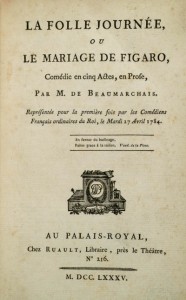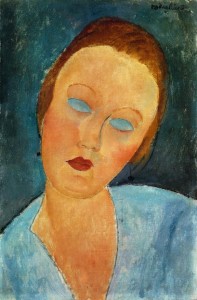Amélie Nothomb, telle une prophétesse en son genre romanesque et abracadabrantesque, nous livre sur un plateau de champagne la clé de son dernier imbroglio, Le crime du comte Neville. Le pire est évité, et le meilleur est à venir… On se croirait presque dans un conte de fées s’il n’y avait pas ce cadavre sur-le-champ.
On a beau dire, il y a du génie dans l’intrigue. La diablesse d’Amélie nous métamorphose en danseurs ne sachant plus sur quelle pointe danser. Des chapitres sans titre ni numéro aux pirouettes incessantes, le lecteur se perd dans un labyrinthe de « ressentis » ignorés : Aucassin – encore un nom à dormir debout – ferme les yeux sur la misère assassine qu’il impose à sa fille. Henri – nous voici revenus au classicisme – terrorisé par la malédiction de sa propre fille, prénommée Sérieuse – pourquoi pas Bêtise au fait chère Amélie? – se noie dans son aveuglante colère. Vous me suivez ?
À moins de lire ce roman farfelu autant que rocambolesque – Rocambole, voici un autre héros marginal – je doute de vos dons de voyance pour me comprendre. Alors, plongez dans le monde d’Oreste, d’Électre et de Sérieuse – trouvez l’intrus – et noyez-vous-y !
Extrait choisi : « …oui, la dernière fête qu’il donnerait au Pluvier serait magnifique. Elle aurait la déchirante splendeur d’un chant du cygne. Il ferait beau, comme toujours le premier dimanche d’octobre dans cette région. Les hêtres auréolant les murs du château arboreraient ce commencement de rousseur qui toucherait davantage qu’une jeunesse absolue. La lumière automnale sublimerait l’ineffable couleur coq-de-roche de la façade, celle que les acheteurs potentiels assassinaient toujours d’un expéditif « Faudra repeindre ! » qui inspirait à Neville un désir de meurtre… »