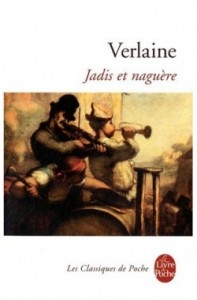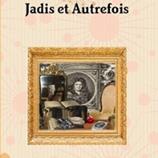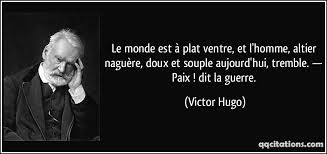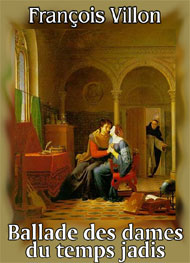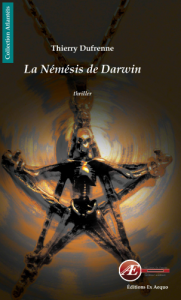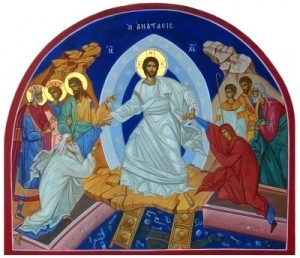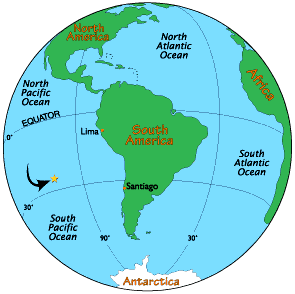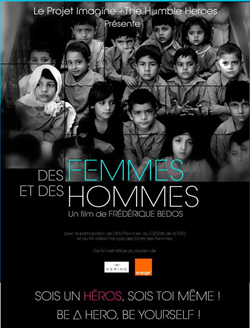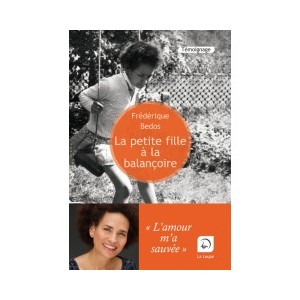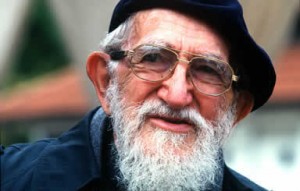Le passé invite parfois à une tristesse rêveuse. Paul Verlaine ne s’y trompe pas en baptisant son recueil de poèmes Jadis et naguère (1884). Des mots justes viennent habiter ce sentiment mélancolique. Jadis, autrefois, naguère et d’antan sont de ceux-là. Ils font écho à un passé vague, mais chacun y dessine sa nuance. Hormis le mot « autrefois » qui est d’un usage courant, les trois autres sont du registre du langage littéraire, soutenu ou poétique. Immisçons-nous dans leurs secrets.
Jadis, adverbe invariable, provient d’une contraction de l’ancien français datant du XIIe siècle, « ja a dis ». Détaillons cette contraction d’antan : « ja » du latin jam, déjà, « a » du verbe avoir signifiant « il y a » et « dis » du latin dies, jours. Nous obtenons alors « il y a déjà des jours » qui se traduit de nos jours par « dans le passé lointain, autrefois, il y a bien longtemps ». Dans l’expression figée « le temps jadis », l’adverbe se construit comme un adjectif épithète. Ex. : Jadis, quand les papes régnaient sur Avignon (de 1309 à 1418). Cela était bon au temps jadis. N’oublions pas de prononcer le S final de jadis.
Autrefois, apparaît donc comme un synonyme de jadis. Adverbe de temps, il signifie « anciennement, dans un passé lointain, jadis ». Au sens propre, il se traduit par « une autre fois ». C’est pourquoi cet adverbe s’appliquait dans l’ancienne langue aussi bien à l’avenir qu’au passé. Ce n’est qu’à la fin du XIIe qu’il ne s’emploie que pour évoquer le passé. Néanmoins, outre son usage plus commun, « autrefois » se réfère à des périodes plus contemporaines que le vocable « jadis » qui lui, correspond à des périodes beaucoup plus anciennes.
L’adverbe naguère nous fait voyager dans son univers poétique. Son écriture rare est parfois fautive. Issu de la contraction du vieux français « n’a guère », le mot littéraire de naguère se traduit au sens propre par « il n’y a pas beaucoup de temps », soit « il n’y a pas longtemps ». Il se rapporte donc à un passé très récent et signifie « récemment, il y a peu de temps ». Or il est moult fois prononcé ou écrit dans le sens de « autrefois, jadis » à tort. On parle alors de glissement de sens. Ex. Naguère, les dinosaures peuplaient la Terre; il faut écrire « Jadis, les dinosaures peuplaient la Terre. » Par contre, il est juste de dire : « Cette usine, naguère si florissante, subit aujourd’hui la crise de plein fouet. » En ancien français « naguères » prenait parfois un S.
Demeurons poètes et faisons résonner les mots d’antan. Du latin classique ante, avant, et annum, année, la locution adjectivale d’antan a pour sens premier, « l’année d’avant, il y a un an ». Autrefois, « antan » s’employait comme nom pour dire « l’année dernière ». De nos jours, il sert de complément prépositionnel d’un nom et désigne désormais un passé lointain synonyme d’autrefois. Ex. Les coutumes d’antan. Ce nouveau glissement sémantique serait dû, selon certains grammairiens, à une mauvaise interprétation du vers de François Villon (1431-1463) dans sa Ballade des dames du temps jadis : « Mais où sont les neiges d’antan ? ». L’intention du poète reste incertaine entre le sens premier de « l’an passé » et celui plus général de « jadis ». Cette poésie sera chantée par Georges Brassens en 1953.
Les jours s’égrainent au fil du temps, naguère de près, d’antan et d’autrefois d’un peu plus loin, et jadis, du fond des âges.